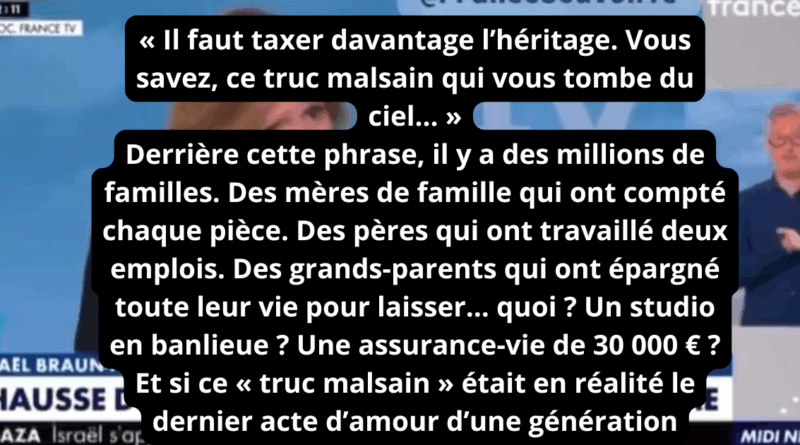Héritage : justice fiscale ou punition des classes moyennes ?
Taxer l’héritage ? Une injustice de plus au nom de l’égalité
« Il faut taxer davantage l’héritage. Vous savez, ce truc malsain qui vous tombe du ciel. » Cette phrase, prononcée avec une désinvolture presque cruelle, résume à elle seule une vision de plus en plus répandue dans les cercles du pouvoir : celle qui considère le patrimoine familial non comme le fruit d’une vie de labeur, mais comme une chance indue, presque une tricherie sociale. Pourtant, derrière chaque héritage, il y a des décennies de travail, de sacrifices silencieux, et souvent, la sueur du front de nos parents, grands-parents — et surtout de nos mères, ces femmes pauvres en biens mais riches en abnégation.
Pourquoi l’héritage n’est pas une manne du ciel
Appeler l’héritage un « truc malsain » relève d’une rhétorique qui efface délibérément la réalité sociale. Ce n’est pas une loterie. Ce n’est pas un chèque surprise envoyé par l’univers. C’est le résultat de carrières entières, de nuits blanches, de boulots mal payés, de crédits remboursés centime par centime.
Et les chiffres le confirment. En 2025, un enfant peut hériter jusqu’à 200 000 € (100 000 € par parent) sans payer le moindre droit de succession. Mais au-delà ? Les taux progressifs s’appliquent rapidement : 20 %, puis 30 %, et même 45 % au-delà de 1,8 million d’euros. Résultat : un héritage de 500 000 € — somme qui paraît colossale mais qui, dans bien des cas, correspond à une maison en région — peut coûter près de 35 000 € en droits. Soit l’équivalent d’une année de salaire net pour un ménage modeste.
Pourtant, selon l’Insee, la moitié des héritages en France sont inférieurs à 63 000 €. Seulement 5 % dépassent les 500 000 €. Autrement dit, ce ne sont pas les milliardaires qui paient l’essentiel de ces impôts — ce sont les classes moyennes, celles qui n’ont ni conseiller fiscal ni holding offshore.
Les Macronistes et la guerre contre la transmission familiale
Depuis 2017, les discours en faveur d’une hausse de la fiscalité successorale se multiplient dans les rangs macronistes. Pas toujours de façon frontale, mais par petites touches : allusions dans les rapports économiques, suggestions dans les interviews, ou formules assassines lâchées en meeting. Le message est clair : transmettre, c’est déjà avoir gagné. Et dans une société qui prône l’égalité des chances, cela devient presque suspect.
Pourtant, la France possède déjà l’un des régimes successoraux les plus lourds d’Europe. Taxer davantage, c’est donc pénaliser non les ultra-riches, mais la classe moyenne et les classes populaires qui espèrent offrir à leurs enfants un peu plus de stabilité — un toit, un coup de pouce pour les études, un apport pour un premier logement.
Quand la justice fiscale devient injustice sociale
Derrière l’argument de l’égalité se cache souvent une forme de mépris de classe. Comme si les familles modestes n’avaient pas le droit de rêver, d’épargner, de transmettre. Comme si seul l’État méritait de décider ce qu’on fait de sa vie, de son travail, et de son patrimoine.
Et puis, soyons clairs : les vrais grands patrimoines savent contourner la fiscalité. Ils ont les moyens de s’entourer de fiscalistes, de créer des structures, de délocaliser. Ce sont les classes moyennes — celles qui ne peuvent pas se payer un conseiller en gestion de patrimoine — qui paient l’addition.
Et si on parlait plutôt de justice réelle ?
Plutôt que de stigmatiser l’héritage, ne vaudrait-il pas mieux s’attaquer aux vraies inégalités ? Celles qui naissent à l’école, dans l’accès à la santé, à l’emploi, au logement. Celles qui empêchent des millions de Français de constituer le moindre patrimoine. Car oui, le vrai problème n’est pas qu’on transmette trop — c’est qu’on ne transmet presque rien à ceux qui partent de zéro.
L’héritage, même modeste, n’est pas un privilège. C’est souvent le dernier acte d’amour d’une génération qui n’a eu que son courage pour capital.